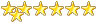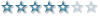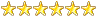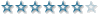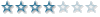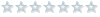Message
par Rouquin » 19 oct. 2010 18:43
Bonjour à tous
Je viens de découvrir ce forum qui aborde un sujet qui m’a immédiatement interpellé étant donné que j’ai déjà moi aussi accompli un travail similaire il y a quelques années. J’ai en effet déjà personnellement effectué un inventaire de ce genre, puisque j’ai passé en revue et révisé la totalité des quelques 4 000 spécimens des collections ornithologiques d’un muséum aquitain. Je possède, par ailleurs, une documentation quasi complète pour la plupart des familles d’oiseaux et pour pratiquement toutes les régions du monde. Je pense par conséquent pouvoir t’aider, si tu es d’accord, dans les cas de déterminations problématiques ou difficiles. Si mon expérience pouvait être profitable à d‘autres, j’en serais ravi. Je ne demande qu’à me rendre utile, dans l’intérêt de chacun, de la science et du patrimoine naturaliste.
Voici mes premières impressions quant aux photos que j’ai pu voir sur ce forum :
Si j’en juge par les diagnostics déjà effectués, il semble qu’il y ait eu quelques problèmes quant aux déterminations initiales (diagnostic ne correspondant pas toujours au spécimen montré ou provenance indiquée incompatible avec l’espèce concernée). Il se pourrait également que certains des spécimens de cette collection aient été changés de socle au fil du temps, comme cela arrive souvent dans les musées, ce qui ajoute évidemment à la confusion.
Page 1
- Je ne garanti pas l’exactitude spécifique du Lamprotornis montré sur la photo. Il faut savoir que les Sturnidés africains du genre Lamprotornis (anciennement Lamprocolius), souvent appelés « Étourneaux (ou Merles) métalliques » (ou encore « Choucadors », vieilli), constituent un groupe très délicat à identifier, dont plusieurs espèces ne sont vraiment déterminables que par examen de la formule alaire.
- L’oiseau marqué « Mino d’Anaïs» est en fait un Ptilonorhynchidé australien (voisin des Paradiséidés, ou Paradisiers), il s’agit d’un mâle d’Oiseau-jardinier du Prince-régent (Sericulus chrysocephalus). Même si les deux espèces se ressemblent superficiellement (même type de pattern et de coloration), elles en diffèrent cependant radicalement si on les compare bien (couleurs identiques mais différemment disposées, et morphologie différente).
- Le Martin-Pêcheur semble bien appartenir à la forme indienne, tel qu’il est marqué, j'ai déjà eu en main un spécimen de cette même race, venant du Bengale, identique à celui de ta photo. cette race est reconnaissable à sa tonalité franchement bleue, la race européenne est beaucoup plus verte à ce niveau. La base rougeâtre de la gnathothèque montre qu’il s’agit d’une femelle.
- Tel qu’il est photographié, le Coucou (Cuculus canorus) est assez déroutant, de profil il montre des yeux noirs, mais de face ses yeux apparaissent blancs ! Je pense à un effet d’optique. Son plumage bigarré des parties supérieures, sa très faible projection alaire et sa queue courte sont les signes de l’immaturité, c’était probablement un poussin tout juste volant, lors de sa capture.
- Concernant le Manakin tijé (Chiroxiphia pareola), ça semble bien être celui-là , mais vérifie quand même l'état de la queue de ce spécimen, parce qu'il n'est pas totalement exclu qu'il puisse s'agir de l'une des espèces à queue ornementale dont les rectrices médianes seraient cassées.
- L’oiseau identifié comme « Sucrier » est en fait un Dicaeidé indonésien, un mâle de Dicée poignardée (Prionochilus percussus).
- L’oiseau marqué « Tangara à croupion jaune » est bien un Tangara (Calliste) varié (Tangara velia) anciennement nomé Tanagrella velia comme l’a très justement fait remarquer un autre intervenant de ce forum. L’étiquette de ce spécimen semble donc bien être celle d‘origine, d‘autant plus que chez cette espèce, le croupion est normalement d‘un beau jaune lorsque le plumage est frais.
Page 2
- La Conure photographiée semble bien être Aratinga mitrata, mais attention aux Conures vertes, dont plusieurs espèces se ressemblent énormément, d’autant plus qu’elles sont sujettes aux variations individuelles. Le « Parrots of the world », de Forshaw et Cooper, est bien plus explicite que le HBW 4 pour les Psittacidés, si tu peux le consulter, tu y verras qu’il y a au moins trois espèces de Conures pratiquement impossibles à déterminer avec certitude de visu, les relevés morphométriques permettent tout juste de les distinguer, et encore !
- Le spécimen nommé « Cotinga bleu (Cotinga nattererii) » est en fait un sujet mâle du Cotinga de Cayenne (Cotinga cayana). Les mâles des deux espèces ne se ressemblent pas vraiment et ne sont pas du tout du même bleu, même s‘il s‘agit bien de deux Cotingidés d‘un même genre.
- Concernant les petits Tangaras jaune et bleu appelés Euphones (ou Organistes), il faut savoir que plusieurs espèces se ressemblent beaucoup et que la difficulté est accrue par le nombre de sous-espèces existantes. Certaines espèces, très voisines d’apparence, comme Euphonia violacea et Euphonia hirundinacea ne peuvent pas être déterminées avec certitude, de visu, et nécessitent une examen plus approfondi. Le spécimen de la photo, nommé « Organiste teité (Euphonia violacea) » pourrait tout aussi bien être un sujet mâle de Euphonia hirundinacea dont les parties claires (le front et l’abdomen) sont d’un jaune pâle, soufré, alors que chez E. violacea ces mêmes parties sont d’un jaune orangé plus vif. Mais il n’est pas impossible que les couleurs aient fané en raison d’une exposition prolongée à la lumière, ou encore que la photo soit surexposée.
- Pour répondre à ta question, il n’existe pas de dimorphisme sexuel évident chez le Kaka (Nestor meridionalis). D’après le « Parrots of the World » cela relève de la morphométrie, mais même dans ce cas il n‘y a rien de sûr.
- Les trois espèces connues de Podarges se ressemblent beaucoup, il faudrait voir la queue plus en détail et avoir quelques données morphométriques pour se prononcer spécifiquement.
Photo 1- Le Coucal photographié semble bien être celui de Madagascar Centropus toulou mais attention quand même, plusieurs espèces de Coucals se ressemblent beaucoup, elles aussi.
Photo 2 - Cet oiseau est un mâle de Tangara (Calliste) passevert (Tangara cayana). Notons qu’il existe chez cette espèce (dont le type vient de Guyane française, d’où son nom) deux formes distinctes, la forme à oreillons noirs et la forme à gorge noire, c’est à cette deuxième variante qu’appartient le sujet exposé ici qui du reste n’est absolument pas décoloré, mais au contraire très bien conservé sur ce point. Les couleurs d’origine physique (comme chez les Tangaras callistes) sont pratiquement inaltérables contrairement aux couleurs d’origine chimique qui elles s’altèrent beaucoup plus rapidement à la lumière.
Photo 3 - L’oiseau montré ici n’a rien à voir avec le Carouge de la Martinique (Icterus bonana), que je connais bien quant à lui. Il s’agit en fait d’un Campéphagidé du sud-est asiatique, bien reconnaissable, c’est un mâle de Petit Minivet (Pericrocotus cinnamomeus). L’étiquette que porte ce spécimen était donc attribuée à l’origine à un autre oiseau, vu que les Campéphagidés sont strictement confinés à l’ancien monde, la plupart étant paléotropicaux, alors que les Ictéridés (dont font partie les Carouges) sont typiquement américains. Cet exemple montre bien qu’on ne doit pas accorder une confiance absolue au contenu des étiquettes (y compris pour les provenances) qui accompagnent les spécimens des collections muséologiques.
Photo 4 - Ce Tangara est un encore un Euphone (ou Organiste) il s’agit d’un sujet femelle de Euphonia musica. En fait, ce spécimen est visiblement de la même espèce que celui qui est nommé « Organiste doré (Euphonia cyanocephala pelzelni) » à la première page du forum. Tu as donc un couple de l’espèce Euphonia musica, place les deux spécimens côte à côte et tu verras qu’ils sont morphologiquement identiques, la différence de coloration résultant simplement du dimorphisme sexuel.
Photo 5 - Encore une espèce néotropicale classique puisqu’il s’agit ici, sans le moindre doute possible, d’un Pipridé bien connu, c’est un mâle de Manakin à tête d’or (Pipra erythrocephala).
Photo 6 - Une autre espèce de Thraupidé (ou Tangaras), celui-ci est un mâle de Tangara à tête rouge (Piranga rubriceps), confiné aux Andes.
Photo 7 - Cette espèce est effectivement, elle aussi, souvent associée aux Thraupidés, mais certains systématiciens préfèrent lui réserver une place à part et le placent dans une famille distincte (Tersinidés). Ce spécimen est un mâle de Tangara (ou Tersine) hirondelle (Tersina viridis).
Photo 8 - Celui là , qui semble te plaire, n’est pas un Estrildidé mais un Embérizidé néotropical, essentiellement confiné au Brésil, il s’agit d’un mâle de Sporophile bouvreuil (Sporophila bouvreuil), ainsi nommé à cause d’une certaine ressemblance avec les Bouvreuils. Rappelons que c‘est à ce même groupe des Sporophiles, qu‘appartiennent la Picolette (Oryzoborus angolensis), bien connue comme oiseau de cage en Guyane, et le « Bouvreuil » antillais (Loxigila noctis) qui remplace, en quelque sorte, les moineaux aux Antilles.
Photo 9 - Il s’agit d’un Cuculidé (Coucou) indonésien, un sujet femelle de Malkoha de Raffles (Phaenicophaeus chlorophaeus). Il est à noter que cet oiseau présente un défaut de montage, la couleur choisie pour les yeux aurait dû être le brun foncé et non le jaune, quant à son bec il aurait dû être repeint en vert et son aptèrie orbitale en verdâtre bleuté.
Photo 10 - Il s’agit bien d’un Guit-guit, une sujet mâle de Guit-guit céruléen (Cyanerpes caeruleus). La couleur jaune des yeux en verre, au lieu de foncé dans la réalité, donne un aspect bizarre à ce spécimen, c’est exactement la même erreur de naturalisation que pour le spécimen précédent. Les Guit-guits sont cousins des Tangaras et ne vivent, comme eux, que dans le Nouveau Monde, la provenance « Guinée » qui semble figurer sur l’étiquette de ce spécimen est donc incompatible avec la réalité, elle était probablement attribuée à l’origine à un autre oiseau de cette collection.
Pour terminer, voici quelques recommandations générales que j’adresse à ceux qui travaillent sur les collections des muséums :
Lorsqu’on inventorie de vieilles collections d’Histoire Naturelle, il convient, en premier lieu, de rechercher si possible, la (ou les) nomenclature(s) ayant servie(s) à l‘auteur des déterminations figurant sur les étiquettes d‘origines, au risque sinon d’assimiler de vieux synonymes avec des erreurs de déterminations originales, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Ne jamais se baser sur un seul bouquin, même s’il bénéficie d’une réputation internationale, comme le HBW. Préférer, dans tous les cas, les ouvrages de références (monographies, faunes régionales) surtout ceux comprenant des clefs dichotomiques, plutôt que ceux plus attractifs, richement illustrés de belles planches et photos en couleur, mais souvent moins fiables et dont les reproductions frisent parfois la caricatures.
Enfin, je ne conseille pas d’essayer de déterminer les sous-espèces sur simple photo, c’est précisément ce qu’il faut éviter de faire si on ne veut pas tomber dans le superflu ou se retrouver dans une impasse, voire passer pour des rigolos. La détermination subspécifique relève, le plus souvent, d’un travail de morphologie comparée et c’est plutôt l’affaire des spécialistes, elle ne peut être sérieusement menée à bien que sur la base d’étude morphométrique et par comparaison de séries de spécimens dans les collections de références. Dans beaucoup de cas, on est d’ailleurs contraint d‘utiliser le système des clefs dichotomiques, or les bouquins de ce genre sont pour la plupart anciens, onéreux et difficiles à trouver. Évidemment, il existe des exceptions comme dans les cas d’espèces ne présentant que deux ou trois races facilement déterminables, mais dans la plupart des cas c’est beaucoup plus nuancé et complexe que ne veulent bien le laisser entendre les bouquins modernes et puis il y a le problème des plumages juvéniles et immatures, beaucoup moins parlant que celui des adultes dans les cas d‘espèces polytypiques ou pluriraciales.
Il me semble important de rappeler, sur ce point, que les volumes du HBW ne sont pas des ouvrages de détermination, ni une nomenclature officielle mais plutôt une sorte d‘encyclopédie ornithologique, certes très élaborée, mais pas vraiment destinée à permettre l‘identification des oiseaux en collection. Ce serait une lourde erreur que de croire que cet ouvrage, au demeurant fort intéressant, indispensable même à plusieurs égards, puisse non seulement remplacer les monographies, mais de plus apporter des réponses à ceux qui voudraient remonter jusqu’au diagnostic subspécifique ou racial. Dans le cas d‘espèces polymorphiques, ne sont illustrées sur le HBW que les formes les plus extrêmes, mais il y a toutes les autres, intermédiaires, seulement énumérées dans le texte et non illustrées. Il est en outre souvent impossible de dresser des limites entre toutes les sous-espèces connues d‘une même espèce, certains systématiciens préfèrent d’ailleurs parler de variations clinales dans ces cas là . Il n’est peut-être pas inutile enfin de rappeler que la systématique n’est pas une science exacte et que les statuts (génériques, spécifiques et subspécifiques) ne sont jamais fixés définitivement. Ce qui était tenu pour vrai hier, ne l‘est souvent plus aujourd’hui et le redeviendra peut-être demain, alors prudence ! Et chaque fois qu’un doute subsiste…s‘abstenir ! Il n’y a aucune honte à suspendre un diagnostic, voire à renoncer à déterminer un spécimen trop douteux. L’expression « sp. ? » Contraction de Scpecies inquirenda = Espèce à rechercher, à déterminer, est très souvent utilisée dans les cercles naturalistes lorsqu’on ne peut pas remonter jusqu’au diagnostic spécifique, elle est le plus souvent précédée d’un nom générique, mais on l‘utilise également lorsque le genre n‘a pus être déterminé.
Voilà , j’espère que mes remarques auront été d’une certaine utilité et que mon aide n’arrive pas trop tard. Tu peux m’envoyer, si tu veux, autant de photos de spécimens qu’il te plaira, j’essayerai de répondre dans la mesure de mes moyens. Ce sera un plaisir de pouvoir t’aider, c’est pour moi une sorte de jeux dont je ne me lasse jamais.
Bien cordialement
 [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img] [/img]
[/img]